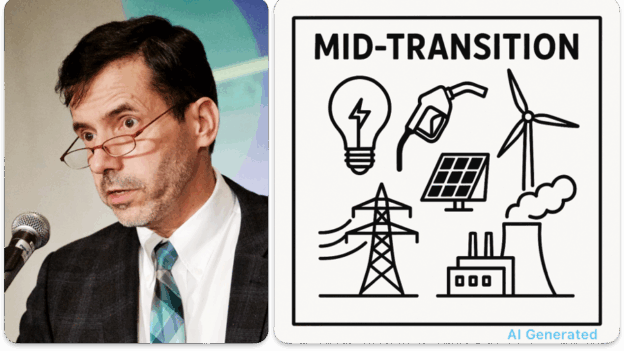La Série mi-transition explore comment des systèmes superposés, des attentes mal alignées et l’inertie institutionnelle façonnent le parcours complexe vers un avenir énergétique propre.
D’abord électrifier, étendre le réseau et rattraper la production
Avant de plonger dans les déséquilibres, les malentendus et les frictions institutionnelles de la transition énergétique, commençons par ce qui est clair et réalisable : prendre des mesures sans regret comme électrifier ce qui est prêt, renforcer le réseau pour le soutenir, et augmenter la production de manière cohérente. Les secteurs plus difficiles à électrifier — comme le transport de marchandises, l’aviation et la chaleur industrielle à haute température — pourront faire l’objet de travaux de R&D ciblés et d’une planification à plus long terme.
Voici comment cela se décline, étape par étape :
1. Électrifier efficacement les secteurs déjà prêts. Électrifier les secteurs où les solutions sont matures : le transport de passagers, le chauffage des bâtiments et les procédés industriels à basse température — tout en mettant en œuvre des mesures d’efficacité énergétique dans les bâtiments et l’industrie pour réduire la demande et le stress sur le système. Ces usages finaux sont technologiquement éprouvés, économiquement viables et offrent des améliorations immédiates en matière d’efficacité, d’émissions et de qualité de l’air. Leur électrification pose les bases de la transformation du système énergétique.
2. Renforcer le réseau — physiquement et intelligemment — en fonction de la nouvelle demande. Les réseaux de transport et de distribution doivent être renforcés et étendus pour accueillir la production distribuée, les charges changeantes, et les besoins croissants en services ancillaires. Parallèlement, des outils numériques — automatisation du réseau, tarification dynamique, prévision en temps réel — sont nécessaires pour gérer la production et la demande de manière plus intelligente. Ces mises à niveau sont non seulement techniques, mais aussi stratégiques : elles rendent le réseau plus flexible, réactif et prêt pour un avenir électrifié et propre.
3. Développer la production — privilégier le propre, mais construire ce qui est nécessaire. De nouvelles capacités doivent entrer en service rapidement. Après des décennies de stagnation de la demande en électricité, l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement — transformateurs, turbines, thermopompes et main-d’œuvre qualifiée — doit maintenant augmenter considérablement. Bien que les énergies à faible taux de carbone (éolien, solaire, hydroélectricité, géothermie et nucléaire) constituent les objectifs finaux, une production fossile de transition peut être nécessaire pour assurer la fiabilité. Les centrales à cycle combiné au gaz (CCGT), par exemple, peuvent être construites relativement rapidement dans des conditions normales et atteignent des rendements de 55 à 62 % — bien que des goulots d’étranglement dans la chaîne d’approvisionnement puissent retarder leur livraison. Couplées à des usages finaux électrifiés et efficaces, elles offrent une solution transitoire pour soutenir la décarbonation sans s’enliser dans des usages qui impliquent émissions à long terme. Heureusement, ma province d’origine, le Québec, dispose d’une abondante hydroélectricité modulable, facilitant l’intégration de l’éolien et du solaire supplémentaires, sans recourir à des centrales à gaz naturel.
4. Investir dès maintenant pour les secteurs difficiles à électrifier. Le transport de marchandises, l’aviation, la chaleur industrielle à haute température — ces secteurs sont plus complexes et nécessiteront des efforts de R&D, des projets pilotes et une politique industrielle soutenue pour parvenir à des solutions propres viables.
Conclusion : Une transition réussie commence par bâtir l’ossature avant d’ajouter la complexité. Il faut jumeler des usages finaux efficaces avec une production efficace. Le réseau doit évoluer avec les deux. Et il faut reconnaître que certaines technologies joueront un rôle de transition. Ce n’est pas la perfection qui est visée aujourd’hui, mais la création de systèmes qui nous permettront de progresser plus rapidement, plus intelligemment et plus durablement vers un avenir énergétique décarboné.
Le secteur des télécoms fournit une leçon précieuse : les réseaux mobiles ne sont pas apparus en un jour. Ils ont évolué par étapes — avec l’attribution de spectre, la construction de tours, la connectivité de retour (backhaul), l’adoption des appareils et l’innovation en matière de facturation. Les planificateurs de l’énergie devraient adopter le même état d’esprit : construire l’ossature d’abord, puis déployer les services et la flexibilité ensuite.
Pourquoi la demande de combustibles fossiles pourrait augmenter (et pourquoi ce n’est pas un échec)
La transition vers un système énergétique bas carbone ne suit pas un parcours linéaire. Durant ce que Emily Grubert et Sara Hastings-Simon appellent la «?mi-transition?», nous vivons avec des infrastructures qui se chevauchent : les anciens systèmes fondés sur les combustibles fossiles restent actifs pendant que les nouvelles technologies propres prennent de l’ampleur.
Dans cette phase, la consommation de combustibles fossiles peut temporairement augmenter — non pas parce que nous échouons, mais parce que l’ancien système est encore nécessaire pour stabiliser ou compléter le nouveau. C’est particulièrement vrai pour les réseaux électriques : avec la montée de l’électrification (véhicules électriques, thermopompes, industrie), la production propre et le stockage ne progressent pas toujours assez rapidement pour répondre de manière fiable aux pointes de demande. Dans ce contexte, il peut être nécessaire de construire de nouvelles centrales au gaz naturel ou au charbon comme solution transitoire pour assurer le bon fonctionnement du réseau. Toutefois, ces centrales fonctionnent à des facteurs de capacité plus faibles au fil du temps, à mesure que la production renouvelable, le stockage et la flexibilité de la demande prennent le relais. On observe déjà cette dynamique en Chine, qui continue d’autoriser la construction de centrales au charbon pour répondre à la demande croissante et garantir la fiabilité du système, surtout lors des périodes de pointe ou de pénuries locales. Pourtant, la production d’électricité à partir du charbon a baissé en 2025, tandis que les énergies renouvelables ont augmenté.
Dans ces cas, l’investissement dans de nouvelles capacités fossiles ne contredit pas la transition, mais la soutient — en agissant comme un tampon temporaire dont l’utilisation diminuera avec le temps. À plus long terme, ces mêmes sites peuvent être réaffectés. Certaines centrales peuvent être modifiées pour fonctionner comme condensateurs synchrones, offrant un soutien en tension et une inertie sans produire d’électricité. D’autres peuvent accueillir des systèmes de stockage par batteries, en tirant parti des interconnexions et des autorisations existantes. Planifier leur réutilisation future dès l’investissement initial permet de réduire les risques d’actifs échoués et d’accroître la flexibilité à long terme du système.
Le monde des télécoms a connu une dynamique similaire. Les abonnements à des lignes terrestres en Amérique du Nord ont continué de croître jusqu’au début des années 2000, alors même que les téléphones mobiles et la téléphonie Internet prenaient leur essor. À la maison, j’avais quatre lignes analogiques — pour la famille, un bureau à domicile, un télécopieur et l’accès Internet par modem — en plus d’un cellulaire analogique et du câble analogique. C’était typique à l’époque : un pic de technologies analogiques juste avant que le haut débit et les téléphones intelligents ne rendent tout cela obsolète. (Nous n’avons maintenant qu’Internet haute vitesse et des téléphones intelligents.) Ce qui ressemblait à une croissance était en fait le dernier soubresaut avant la rupture. Maintenir tous ces systèmes pouvait sembler inefficace, mais c’était nécessaire. Il en va de même pour l’énergie : des infrastructures qui se chevauchent ne sont pas le signe d’une mauvaise planification, mais une caractéristique normale de toute transition.
Il faut donc reconnaître ces pics non comme des échecs, mais comme des signes que le changement de système est en cours. Ce qui est essentiel, c’est de planifier leur obsolescence même lorsqu’ils continuent de croître temporairement.
L’efficacité est l’héroïne cachée
L’efficacité énergétique est souvent négligée dans les discussions énergétiques, et pourtant, elle est un moteur fondamental de réduction des émissions et d’amélioration de la performance des systèmes. Les systèmes électrifiés, comme les véhicules électriques (VE) et les thermopompes, sont nettement plus efficaces que leurs équivalents alimentés aux combustibles fossiles — même lorsqu’ils sont alimentés par des réseaux encore partiellement fossiles. Par exemple, les VE convertissent plus de 80 % de l’énergie de la batterie en mouvement, contre moins de 25 % pour un moteur à essence. Les thermopompes peuvent fournir trois à quatre unités de chaleur pour chaque unité d’électricité, surpassant largement les chaudières à mazout ou à gaz.
Au Québec, où l’électricité représente déjà près de 50 % de la consommation finale d’énergie grâce à l’hydroélectricité, remplacer les systèmes au mazout restants par des thermopompes offre des avantages environnementaux et économiques immédiats. De plus, une grande partie du parc résidentiel québécois des années 1970 et 1980 est équipée de plinthes électriques. Ces systèmes sont simples, mais très gourmands en énergie. Les remplacer par des thermopompes pour climat froid avec thermostats intelligents améliore non seulement l’efficacité énergétique des ménages, mais libère également une capacité réseau précieuse pendant les pointes hivernales — capacité qui peut ensuite servir à d’autres usages, comme les VE.
Les gains d’efficacité ne se limitent pas aux équipements. Isoler les bâtiments, colmater les fuites, améliorer les fenêtres, moderniser les procédés industriels : toutes ces actions réduisent la demande, les coûts énergétiques et la pression sur le réseau. Un bon exemple industriel est l’adoption des moteurs à vitesse variable (VFD), qui ajustent la vitesse et le couple d’un moteur en fonction de la demande réelle, réduisant ainsi considérablement la consommation énergétique des pompes, ventilateurs et compresseurs — des usages majeurs en milieu industriel. Ces actions sont habituellement des décisions sans regret : elles sont peu risquées, peu coûteuses, mais avec un impact élevé.
Même dans les régions où le réseau électrique dépend encore largement des combustibles fossiles, ces mesures réduisent les émissions sur l’ensemble du cycle. L’efficacité doit donc être vue non pas comme un avantage secondaire, mais comme un levier stratégique de la transition énergétique.
Dans le secteur des télécoms, les systèmes mobiles précoces présentaient des compromis similaires. Les systèmes numériques initiaux — comme la voix sur IP ou les commutateurs numériques — étaient souvent moins efficaces que leurs homologues analogiques en termes de bande passante. Transmettre correctement des 1 et des 0 nécessitait plus de fidélité et plus de bande passante que transmettre une voix analogique. La qualité sonore et la latence étaient parfois inférieures. Pourtant, ces plateformes numériques ont permis de nouveaux services, ont évolué rapidement et ont gagné en performance à grande échelle. Il en va de même pour l’électrification : les premières phases peuvent être imparfaites, mais elles permettent de bâtir une architecture dynamique, numérique et en constante amélioration.
L’efficacité — qu’il s’agisse de physique ou de capacité d’adaptation — est la raison pour laquelle l’électrification réduit déjà les émissions et prépare le terrain pour une décarbonation plus profonde. Cet avantage rejoint la logique de la Partie 1 : que ce soit par la production efficace de centrales au gaz à cycle combiné ou par des usages électrifiés, comme les VE et les thermopompes, choisir les technologies les plus efficaces disponibles aujourd’hui est une manière sans regret de réduire les émissions et d’améliorer les performances du système.
Le défi consiste donc à voir comment on peut déployer rapidement et efficacement l’électrification.
Gouverner en déséquilibre
La mi-transition est marquée par la complexité : des technologies qui évoluent rapidement, des institutions lentes à s’adapter, et des systèmes existants qui ne peuvent disparaître du jour au lendemain. Tous les secteurs ne progressent pas au même rythme, et les politiques publiques doivent tenir compte de cette hétérogénéité. Par exemple, le chauffage résidentiel et les véhicules légers peuvent être rapidement électrifiés, tandis que l’industrie lourde ou le transport longue distance nécessitent plus de temps et un soutien ciblé en R&D. Une approche différenciée — ajustant les outils et les échéanciers selon la maturité de chaque secteur — donne de meilleurs résultats qu’un cadre unique pour tous.
Les politiques doivent refléter cette réalité. Les incitatifs sont souvent essentiels pour accélérer l’adoption des technologies d’électrification, surtout pour les usages finaux où les coûts initiaux constituent un frein. Des subventions pour les thermopompes, les véhicules électriques, les appareils intelligents et les rénovations énergétiques peuvent stimuler la demande, créer des économies d’échelle dans la fabrication et l’installation, et transformer plus rapidement le marché — à condition que ces incitatifs soient conçus pour disparaître progressivement à mesure que les marchés arrivent à maturité et que les coûts baissent. En parallèle, les outils réglementaires — comme les normes du bâtiment, les règlements sur les émissions de véhicules ou les critères de performance des services publics — jouent un rôle crucial dans l’encadrement de l’électrification, de l’extension du réseau et de l’ajout de capacités de production. Ensemble, incitatifs ciblés et réglementation rigoureuse forment les conditions nécessaires à une décarbonation coordonnée.
La R&D, les subventions et la gouvernance devraient privilégier les innovations à cycles rapides (comme les ressources énergétiques distribuées, les outils numériques ou le stockage décentralisé), qui offrent des gains rapides et permettent un apprentissage accéléré. Ces investissements doivent être complétés par un soutien de plus long terme pour les technologies fondamentales dans les secteurs plus difficiles à décarboner, ainsi que par des stratégies de sortie pour les infrastructures fossiles : reconversion des travailleurs, réaffectation des actifs, redistribution des capitaux.
La tarification du carbone et les réformes de marché sont des outils — pas des solutions miracle. Si la tarification du carbone peut réduire les émissions dans certains secteurs, elle est peu efficace à elle seule pour transformer des infrastructures complexes. Le système électrique n’est pas un marché pleinement libéralisé : il est composé de monopoles régulés, de longues périodes de planification, et d’obligations d’intérêt public. Sans politiques complémentaires — comme des normes, des investissements publics ou des réformes institutionnelles — les signaux de prix risquent de renforcer le statu quo. Dans les systèmes caractérisés par des actifs durables, des acteurs dominants et des rigidités planificatrices, un prix du carbone peut augmenter les coûts sans générer de changement structurel. Il peut freiner la consommation sans permettre les conditions nécessaires pour transformer la production, la distribution et l’utilisation de l’électricité. Comme pour les télécoms, ce n’est pas la réforme des prix qui a permis la transformation numérique, mais l’ouverture institutionnelle à de nouveaux acteurs, à de nouvelles technologies et à de nouveaux modèles d’affaires. Un ensemble cohérent de marchés de capacité (pour assurer la fiabilité), de tarifs flexibles (pour moduler la demande) et de programmes équitables (pour soutenir les ménages vulnérables) doit occuper le devant de la scène.
Les autorités de régulation dans les télécoms ont réagi lentement pendant la révolution mobile, tentant d’appliquer des règles obsolètes pensées pour les services analogiques à un monde numérique en rapide évolution. Cette inadéquation a ralenti l’innovation et accru les frictions — une leçon à méditer pour les autorités de régulation de l’énergie qui font face à une rupture similaire.
Historiquement, les télécommunications étaient organisées autour de monopoles. Mais l’arrivée de concurrents — câblodistributeurs, fournisseurs mobiles multiples, services Internet — a obligé les régulateurs à revoir en profondeur le cadre du secteur. Il en est ressorti un écosystème dynamique et pluraliste, avec des modèles d’affaires et des plateformes qui se chevauchent et qui ont évolué selon leurs propres rythmes.
Le secteur énergétique pourrait vivre une transition semblable. Les ressources énergétiques distribuées — comme le solaire résidentiel, les batteries, le V2G et les agrégateurs — remettent en question le modèle unidirectionnel centralisé. Par ailleurs, de nouvelles formes institutionnelles — régies municipales, coopératives, entreprises autochtones — prennent leur essor. Ces acteurs brouillent les frontières entre consommateur et producteur, infrastructure et service, public et privé.
La régulation devra s’adapter — pas en copiant le modèle des télécoms, car le résultat final variera selon les juridictions, mais en adoptant la même logique : ouverture à la décentralisation, à l’innovation, et à la diversité des modèles. Un cadre réglementaire souple et pluraliste sera essentiel pour gérer cette complexité et éviter les frictions qui ont ralenti la transition numérique des télécoms.
Comme les télécoms l’ont fait, les systèmes énergétiques devront accueillir les initiatives municipales, les formes de propriété communautaire et l’intelligence côté utilisateur.
Mal interpréter la transition
Les systèmes énergétiques d’aujourd’hui font face à des défis étonnamment similaires à ceux des réseaux télécoms lors de leur transition numérique. Les technologies numériques comme le DSL ou la voix sur IP ont dû coexister avec les systèmes analogiques pendant des décennies, générant des frictions dues aux incompatibilités de protocoles, aux systèmes de facturation désuets et aux attentes variables en matière de qualité de service. De même, les technologies énergétiques propres — du solaire distribué aux thermostats intelligents — sont déployées dans une infrastructure pensée pour une production centralisée, pilotable et fossile. Les codes du réseau — les normes techniques de connexion — ainsi que les règles d’interconnexion et les modèles tarifaires accusent souvent un retard sur les capacités et les besoins des nouvelles technologies. Comme dans les télécoms, les institutions énergétiques doivent revoir les règles, développer de nouvelles compétences et accepter des transformations structurelles. La coexistence de l’ancien et du nouveau n’est pas un bogue temporaire : c’est la caractéristique centrale de la mi-transition.
Les systèmes de transition ne progressent pas linéairement — ils oscillent. Un excédent dans une partie de la chaîne de valeur (par exemple, les modules solaires ou les batteries) peut découler de blocages ailleurs (permis, délais d’interconnexion, intégration réseau). Ces déséquilibres entraînent souvent des effondrements de prix ou des surplus, non pas parce que les technologies ont échoué, mais parce que le reste du système n’a pas suivi. Ce phénomène a été observé à répétition dans le secteur solaire : des cycles de croissance stimulés par les incitatifs, suivis de replis lorsque le déploiement ne suit pas. Ces fluctuations envoient des signaux contradictoires, troublent les investisseurs et les responsables politiques, et peuvent saper la confiance du public. Comprendre cette volatilité comme une manifestation du déséquilibre — et non de l’échec — est essentiel.
Un exemple révélateur est la modernisation de sites. Dans l’extraction fossile, un site est abandonné lorsque la ressource s’épuise. Mais dans les énergies renouvelables, réaménager un ancien site solaire ou éolien avec des technologies plus récentes — un processus appelé «?repowering?» — permet souvent d’augmenter la productivité et de réduire les coûts. Pourtant, ce processus peut donner l’impression d’un gaspillage prématuré ou d’un échec. Reconnaître cette logique différente dans l’évolution des infrastructures est essentiel pour bien interpréter les signaux visuels de la transition énergétique.
Autre exemple révélateur : les compteurs intelligents. Dans plusieurs juridictions, cette infrastructure est déjà installée — souvent à grands frais publics — mais ses bénéfices restent inégalement réalisés. Les tarifs dynamiques, les informations en temps réel, ou l’automatisation de la demande ne peuvent pas être activés par les compteurs seuls : ils nécessitent des cadres réglementaires adaptés, l’engagement des services publics et la confiance des clients. Ce fut aussi le cas dans les télécoms : au début des années 2000, des réseaux large bande sous-utilisés étaient en place, mais les modèles de service et la demande ne suivaient pas encore. Cela souligne un thème récurrent de la mi-transition : le déploiement physique doit être accompagné d’une préparation institutionnelle et d’une intégration côté utilisateur.
Les télécoms offrent une autre leçon : la fréquence et la rapidité des renouvellements de systèmes. En quelques décennies, l’industrie a connu plusieurs générations de téléphonie mobile — 2G, 3G, LTE, 4G, 5G — et de technologies Internet — DSL, câble coaxial, fibre jusqu’au domicile — chacune exigeant de lourds investissements en infrastructures. Les câbles cuivre et coaxiaux ont été remplacés par la fibre?; les réseaux ont été démantelés et reconstruits. Cette logique de renouvellement continu était la norme. En revanche, les systèmes électriques sont conçus pour durer — entre 40 et 80 ans. Cette vision de long terme rend le renouvellement régulier contre-intuitif, voire suspect. Pourtant, la transition énergétique exigera des réinvestissements plus fréquents, notamment pour moderniser les premières vagues d’équipements solaires, éoliens et réseaux. Comprendre cette différence de culture et d’institutions est crucial : ce que les télécoms considéraient comme une voie vers le progrès, l’électricité pourrait le percevoir comme un gaspillage — à son propre détriment.
Un autre signal souvent mal interprété est le délestage (curtailment) — la réduction volontaire de la production renouvelable lorsque l’offre dépasse temporairement la demande ou la capacité du réseau. Cela peut sembler être un gaspillage, comme si l’on jetait de l’électricité propre. Mais dans un système fortement renouvelable, un certain niveau de délestage est normal et économiquement sensé. Il permet aux planificateurs de dimensionner la production pour couvrir la majorité des besoins, en acceptant des surplus occasionnels comme compromis en faveur de la résilience. En fait, une stratégie de surcapacité (et donc de délestage) peut être plus rapide et moins coûteuse à court terme qu’une expansion du réseau ou du stockage. Comme pour le repowering, les apparences peuvent induire en erreur : ce qui semble inefficace reflète en réalité une logique optimale à l’échelle du système.
Conclusion
La mi-transition est désordonnée, mais maîtrisable. La comprendre, c’est accepter que les systèmes doubles, les contradictions temporaires et les technologies en évolution rapide ne soient pas des échecs, mais les signes d’un progrès réel. De la même façon que les télécoms ont traversé des réseaux qui se chevauchaient, des retards réglementaires et une confusion publique avant de changer en profondeur, le système énergétique doit faire de même — mais avec des enjeux plus importants et moins de temps. En misant sur les actions sans regret, en misant sur l’efficacité, en alignant la gouvernance sur la technologie et en anticipant les malentendus, on peut concevoir une transition plus rapide, plus propre, mais aussi plus équitable et plus intelligente. La transition est en cours. Elle ne sera pas parfaite. Mais elle peut être planifiée.