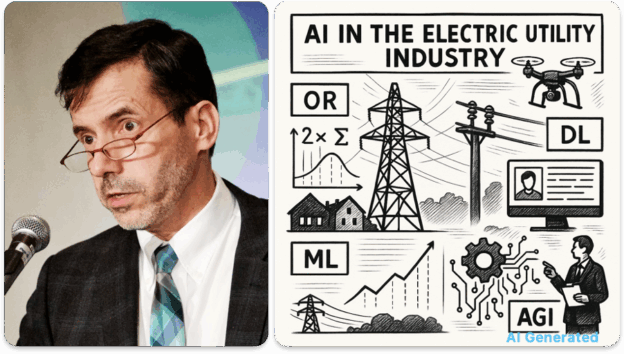(LinkedIn : https://www.linkedin.com/pulse/de-la-recherche-op%25C3%25A9rationnelle-%25C3%25A0-lagi-lia-dans-benoit-marcoux-vowue/)
L’intelligence artificielle dans les compagnies d’électricité évolue depuis des décennies à travers des techniques complémentaires, comme la recherche opérationnelle (Operational Research, OR), l’apprentissage automatique (Machine Learning, ML) et, plus récemment, l’apprentissage profond (Deep Learning, DL), qui constitue la base des systèmes actuels d’IA générative (GenAI), tels que ChatGPT. Bien que les discussions sur l’intelligence artificielle générale (AGI) restent largement spéculatives, les outils déjà disponibles transforment la manière dont les compagnies d’électricité planifient et exploitent leurs réseaux.
J’ai conçu des systèmes dans les années 1980 qui, selon les définitions actuelles, seraient considérés comme de la recherche opérationnelle et de l’apprentissage automatique, à une époque où la première était déjà bien établie, mais où le second en était encore à ses débuts. Cette expérience précoce ne fait pas de moi un expert en IA, surtout aujourd’hui, mais elle me donne une perspective sur la façon dont les vagues technologiques montent, retombent et reviennent sous de nouvelles formes. Pour les compagnies d’électricité aussi, l’histoire de l’IA relève moins d’une rupture soudaine que d’une évolution graduelle de méthodes analytiques bien connues.
La recherche opérationnelle soutient les systèmes électriques depuis des générations. Pensons aux courbes t?c des disjoncteurs de postes, au délestage de charge en cas de sous?fréquence (Under Frequency Load Shedding, UFLS), à l’optimisation des flux de puissance, à la planification hydroélectrique, à la coordination des arrêts, à la logistique et à l’allocation des ressources. L’OR demeure la base des opérations et de la planification du transport.
L’apprentissage automatique s’est appuyé sur cette base dans les années 1990 et 2000. Les compagnies d’électricité ont commencé à l’utiliser pour la prévision : charge, production renouvelable et même prix sur les marchés déréglementés. La détection de pannes, la maintenance prédictive des transformateurs et câbles, ainsi que la détection d’anomalies dans les domaines physique et cybernétique, font partie de cette vague.
L’apprentissage profond émerge aujourd’hui et se combine aux applications de GenIA. Les drones dotés de vision artificielle aident à la gestion de la végétation et à l’inspection des lignes, tandis que le traitement du langage naturel soutient les centres d’appels et les rapports de pannes. Le DL et la GenAI sont également de plus en plus utilisés pour des tâches d’ingénierie des données, comme les processus ETL (extraire, transformer, charger) et la validation de données lors de la modernisation des systèmes informatiques (TI) ou opérationnels (TO). Les manuels d’exploitation de plusieurs milliers de pages peuvent être intégrés à des modèles de langage (Large Language Models, LLM) afin de fournir des réponses simplifiées au personnel de terrain, réduisant ainsi le besoin de formation approfondie. De grandes entreprises technologiques publient des outils conçus pour aider à ces tâches, comme les agents d’IA de Google destinés aux équipes de données. Ces outils peuvent accélérer l’intégration, mais reposent toujours sur une gouvernance rigoureuse des données et une expertise métier solide.
L’AGI constitue l’étape théorique suivante. Cependant, les compagnies d’électricité ne devraient pas la poursuivre pour elle-même. Les gains pratiques proviennent de systèmes adaptés à la gestion du réseau, au service à la clientèle et à la santé des actifs — des problèmes concrets qui exigent des solutions explicables et conformes aux exigences réglementaires.
De nombreuses compagnies d’électricité ont hésité à adopter même des applications éprouvées d’OR ou de ML. La maintenance préventive, par exemple, a souvent été écartée au profit de stratégies d’exploitation jusqu’à la défaillance. Cette réticence n’est pas uniquement technique : une gouvernance des données faible, des télécommunications inadéquates et un conservatisme culturel ou réglementaire ont tous contribué à ce retard. Paradoxalement, ces mêmes approches sont parfois adoptées plus facilement lorsqu’elles sont présentées sous l’étiquette «?IA?». Le véritable défi pour les compagnies d’électricité n’est donc pas technologique, mais organisationnel, nécessitant une gestion, une gouvernance et une formation à la hauteur du rythme de l’innovation.
Les systèmes d’IA générative (GenAI) et les grands modèles de langage (LLM) comportent également des risques d’erreurs. Ces systèmes, fondés sur l’apprentissage profond, peuvent générer du texte, du code ou des réponses à des requêtes, ce qui en fait des outils puissants pour simplifier l’accès à l’information. Toutefois, je les utilise moi?même pour l’écriture, et s’ils accélèrent les 80 % initiaux du travail, ils font encore des erreurs. Cela peut convenir pour la rédaction de texte révisé par un humain averti, mais pas pour les systèmes essentiels à la mission, où la sécurité et la fiabilité priment.
Défis liés aux données
La principale contrainte pour les compagnies d’électricité ne réside pas dans les algorithmes, mais dans la qualité et la gestion des données. Les réseaux de transport sont relativement bien instrumentés, mais les réseaux de distribution sont complexes : millions d’actifs dispersés, dossiers fragmentés et systèmes hérités. À mesure que se multiplient les ressources énergétiques distribuées (Distributed Energy Resources, DER) et les compteurs intelligents, le volume de données explose. La gouvernance, l’interopérabilité et la cybersécurité doivent passer en premier. Une mauvaise qualité de données limite aussi l’entraînement et la validation des modèles d’IA, ce qui fait de la gestion des données une condition préalable à des résultats crédibles. Le DL et la GenAI peuvent contribuer à nettoyer et à intégrer ces données, mais seulement si des cadres solides sont en place.
Défis organisationnels et de mise en œuvre
Les compagnies d’électricité sont axées sur la fiabilité et la prudence, à juste titre. Mais cette culture rend l’adoption des outils numériques difficile. Les projets d’IA exigent des compétences hybrides : expertise en systèmes électriques et en modèles d’IA. La requalification et la culture numérique sont essentielles. La gestion du changement constitue souvent le principal obstacle. Un autre frein est la faible tolérance à l’expérimentation. Contrairement aux entreprises technologiques qui consacrent des équipes entières à tester et itérer de nouveaux outils, la plupart des compagnies d’électricité hésitent à investir dans des projets dont les résultats sont incertains, même lorsque la valeur d’apprentissage est élevée. Certaines tâches peuvent être simplifiées sans beaucoup de formation?; les LLM capables de répondre à des requêtes à partir de manuels techniques volumineux en sont un bon exemple, mais la plupart nécessitent une intégration plus profonde aux pratiques existantes.
Les organismes de réglementation exigeront également de la transparence. Si l’IA est utilisée pour prioriser les pannes ou optimiser les tarifs, les décisions devront être explicables. Certaines approches, comme l’OR et de nombreux modèles de ML, sont relativement transparentes dans leurs résultats, tandis que l’apprentissage profond et les LLM fonctionnent souvent comme des «?boîtes noires?», rendant la justification plus difficile. L’explicabilité est essentielle non seulement pour la qualité des modèles, mais aussi pour la confiance du public, la conformité réglementaire et la capacité d’auditer les décisions qui affectent la fiabilité et le service aux clients. La foi aveugle dans les promesses d’«?IA magique?» ne résistera pas à l’examen réglementaire ou opérationnel. En fait, les compagnies d’électricité font souvent davantage confiance à l’expérience réelle de leurs pairs qu’au marketing des fournisseurs. Les fournisseurs qui réussiront seront ceux qui agiront comme des ponts de connaissance patients, apportant les leçons et les perspectives d’autres compagnies d’électricité à travers le monde sur la façon dont l’IA a été déployée efficacement, plutôt que de simplement vendre de la technologie.
Nouvelle demande en électricité
L’IA n’est pas seulement une solution?; elle crée aussi une nouvelle demande d’électricité. Les grands centres de données d’IA consomment désormais de l’électricité à des niveaux comparables à ceux d’une aluminerie. Cette charge croissante accentue la pression sur des réseaux déjà sollicités. S’ajoutent les préoccupations quant à l’endroit où les données sont stockées : si des données critiques sont conservées à l’étranger ou susceptibles d’être partagées avec des gouvernements étrangers, des questions de souveraineté, de sécurité et de conformité réglementaire se posent.
La voie à suivre
La prochaine étape pour les compagnies d’électricité ne consiste pas à courir après l’AGI, mais à devenir de véritables organisations prêtes pour l’IA en se concentrant sur :
- le renforcement de la gouvernance et de l’interopérabilité des données?;
- la gestion rigoureuse des projets TI/TO?;
- le développement des compétences de la main?d’œuvre en IA et en culture des données?;
- la priorité donnée à l’explicabilité et à la conformité réglementaire.
L’IA ne remplacera pas les fondements de l’électricité, comme la sécurité, la fiabilité et l’efficacité, mais elle peut les renforcer. Le défi tient moins aux algorithmes qu’à la manière dont les compagnies d’électricité gèrent leurs données, leurs infrastructures et leurs équipes. Ceux qui maîtriseront la gouvernance et la qualité des données aujourd’hui seront ceux qui façonneront la manière dont l’IA transformera le réseau de demain.