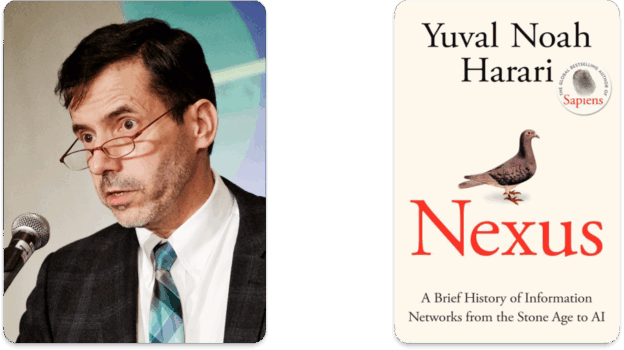Que se passe-t-il lorsqu’on cesse de croire à une vérité partagée? Lorsque l’indignation prend le dessus sur la compréhension? Lorsque le pouvoir découle non pas de la connaissance, mais de la curation?
Nexus n’est pas un livre sur l’énergie. Mais il éclaire en profondeur la manière dont nous prenons des décisions collectives – qu’il s’agisse du climat, de la démocratie ou de la survie de nos sociétés. L’idée centrale de Harari est que les humains ne prospèrent pas en découvrant la vérité objective, mais en tissant des fictions communes qui permettent la coopération à grande échelle. Cela vaut autant pour les religions et les nations… que pour les politiques énergétiques.
Dans le secteur de l’énergie, on présume souvent que les faits guideront l’action. On chiffre les émissions, on modélise les scénarios, on publie des feuilles de route techniques. Mais Harari nous rappelle que la vérité seule ne suffit pas. Ce sont les récits, les institutions et les désirs collectifs qui orientent véritablement les choix.
Prenons l’exemple du climat : Harari critique l’idée de “faire ses propres recherches” comme voie vers la vérité. Il a raison. Personne ne peut, à lui seul, valider la science du climat, la dynamique des réseaux électriques ou les calculs d’émissions. Nous dépendons d’institutions de curation : universités, médias, régulateurs, et même compagnies d’électricité. Si ces institutions perdent leur légitimité, notre capacité à agir collectivement s’effondre.
Il tire aussi un parallèle avec l’intelligence artificielle : à mesure que des intelligences non humaines structurent nos récits et exploitent nos biais, le pouvoir de curation – c’est-à-dire de décider ce qui compte comme “vérité” – devient central. Comme ceux qui ont déterminé le canon biblique, ceux qui forment les IA ou sélectionnent les scénarios énergétiques jouent un rôle décisif dans l’avenir.
Que signifie cela pour le secteur de l’énergie?
- Démocratie et légitimité : Les institutions énergétiques doivent devenir plus transparentes, plus pluralistes, plus responsables. Une planification perçue comme technocratique ou opaque sera rejetée – même si elle est fondée.
- Désir plutôt que vérité : Choisir entre sobriété climatique et croissance économique n’est pas une décision technique, mais un choix de société. Il faut donc des politiques énergétiques qui parlent aux valeurs.
- Divergence géopolitique : Harari craint un découplage des sphères numériques. Un phénomène similaire pourrait se produire dans les systèmes énergétiques. Le Canada doit faire des choix clairs : infrastructures, normes, alliances.
- Pouvoir du récit : Harari ne rejette pas la fiction. Il en reconnaît l’utilité sociale. Le secteur énergétique a besoin de meilleurs récits : crédibles, mobilisateurs, partagés. Pas de l’utopie, mais des visions collectives assez fortes pour guider l’action.
En résumé, Nexus est un appel à prendre au sérieux l’infrastructure narrative de nos sociétés. Pour réussir la transition énergétique, il nous faudra plus que de l’innovation ou des investissements : il nous faudra des institutions curatrices fiables, un désir collectif éclairé… et des récits qui nous relient.