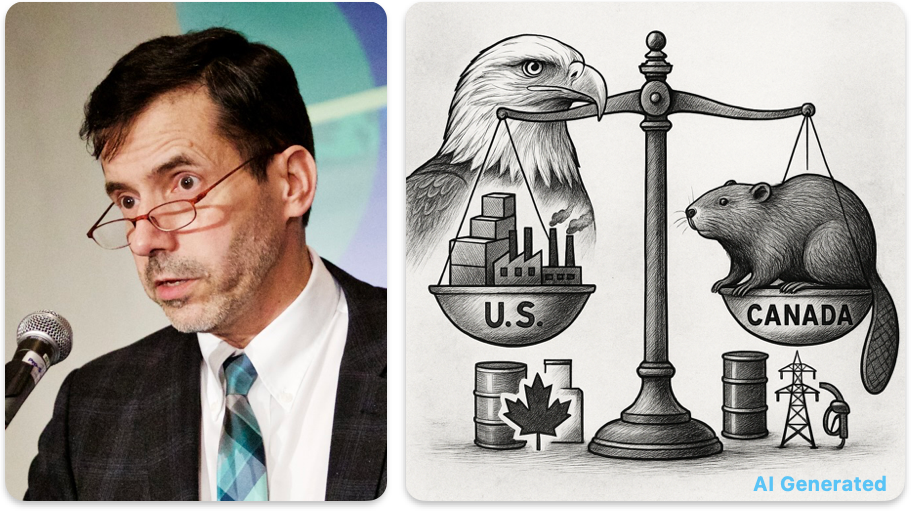
À l’heure où les tensions commerciales s’intensifient — notamment sous la menace de nouveaux tarifs par l’ancien président Trump — il est essentiel de distinguer la rhétorique des faits. L’idée que le Canada profite des États-Unis fait abstraction de réalités fondamentales : sécurité énergétique, flux d’investissements, intégration industrielle et coopération en matière de défense. En vérité, le Canada a constamment soutenu la prospérité et la résilience américaines — non seulement en tant que fournisseur clé, mais aussi comme allié de confiance dans plusieurs domaines.
(LinkedIn: https://www.linkedin.com/pulse/commerce-canadaétats-unis-mythes-réalités-et-le-rôle-de-marcoux-krnwe/))
1. Le Canada alimente littéralement l’industrie américaine
Comme l’a écrit l’économiste Paul Krugman, « importer ce dont vous avez besoin — obtenir des choses d’autres pays — est l’objectif du commerce international. Exporter — envoyer des choses à d’autres pays — est ce que nous faisons pour payer nos importations ». Cette logique s’applique parfaitement aux exportations canadiennes d’hydroélectricité : une source propre, fiable et bénéfique pour les consommateurs et l’industrie des États-Unis.
Le Canada est le plus grand fournisseur étranger d’énergie des États-Unis. En 2024, les exportations canadiennes de pétrole, de gaz et d’électricité vers les États-Unis ont atteint environ 124 milliards $?US. Ce sont des intrants essentiels pour l’industrie américaine et la vie quotidienne.
Fait notable, le pétrole et le gaz canadiens sont souvent vendus à prix réduit par rapport aux références mondiales, en raison des goulots d’étranglement du transport et de l’accès limité aux marchés. Cela signifie que les acheteurs américains bénéficient non seulement d’une source sûre et amicale, mais aussi de prix plus bas — un avantage économique direct.
Et l’énergie n’est que le début. Le Canada exporte chaque année près de 2,8 millions de tonnes d’aluminium vers les États-Unis — soit presque la moitié de leurs importations. Remplacer cet aluminium canadien par une production américaine nécessiterait près de 40 TWh supplémentaires d’électricité, soit l’équivalent de la consommation annuelle de 3,6 millions de foyers américains.
2. Le Canada fournit les intrants — les États-Unis vendent les produits finis
Plus de 98?% des biens échangés sont exemptés de droits en vertu de l’ACEUM. Selon les chiffres officiels, les droits perçus représentent moins de 1,5?% de la valeur du commerce bilatéral, soit environ 9 milliards $?US sur 620 milliards.
Au-delà de l’énergie, le Canada fournit des intrants industriels essentiels : aluminium, pièces d’automobile, produits forestiers, minéraux — tous indispensables à la production américaine. Les tarifs imposés sur ces biens augmenteraient les coûts pour les entreprises américaines.
En 2023, le Canada a assemblé 1,32 million de véhicules exportés aux États-Unis, tandis que les États-Unis ont exporté 1,7 million de véhicules vers le Canada. Cela illustre l’interdépendance, mais aussi l’asymétrie : les biens exportés par le Canada sont des intrants difficiles à remplacer, tandis que les biens exportés par les États-Unis sont des produits finis plus facilement substituables.
La gestion de l’offre canadienne (produits laitiers, œufs, volaille) est parfois critiquée, mais son impact sur les exportations américaines est limité. Par contraste, les tarifs américains sur le bois d’œuvre nuisent directement aux producteurs canadiens et aux consommateurs américains.
Les services sont l’un des rares domaines où les États-Unis affichent un excédent — de 31,7 milliards $?US — grâce à des secteurs comme la finance, le numérique, les conseils et le tourisme. Toutefois, ces services pourraient eux aussi être remplacés à long terme.
3. Les flux de capitaux favorisent les États-Unis
Le Canada investit plus de 600 milliards $?US dans l’économie américaine : usines, infrastructure, innovation, obligations du Trésor. Ces investissements renforcent la croissance et la stabilité économique des États-Unis.
À l’inverse, les investissements américains au Canada sont moindres et moins diversifiés. Le Canada affiche ainsi un déficit structurel dans le compte de capital.
Et cela pourrait changer : en cas de guerre commerciale, le Canada pourrait réorienter ses investissements ailleurs.
4. Défense et diplomatie
- Le Canada héberge le système d’alerte du Nord, clé pour la surveillance continentale.
- Il codirige le NORAD, basé au Colorado, mais actif jusque dans l’Arctique.
- Il a participé à des missions de combat comme en Afghanistan (158 soldats canadiens morts).
- Il achète du matériel militaire américain : avions, hélicoptères, blindés.
Après le 11 septembre, le Canada a accueilli 33?000 passagers aériens détournés. Il a aussi sauvé six diplomates américains pendant la crise des otages en Iran.
Ces gestes témoignent d’une alliance stratégique et durable.
5. Programmes sociaux : une efficacité, pas une dépendance
Le Canada consacre 12 % de son PIB à la santé (contre 18 % aux É-U), pour des résultats meilleurs : espérance de vie plus élevée, mortalité maternelle plus faible.
L’économie dépasse 6?900 $ US par personne.
Cela permet d’investir dans d’autres domaines : garderies universelles, congés parentaux payés, prestations pour enfants, soutiens au revenu.
Ces programmes sont le fruit de choix stratégiques, pas d’un sous-investissement ailleurs.
6. Fentanyl ? Mauvaise frontière
Le fentanyl vient de la Chine et du Mexique, pas du Canada. En réalité, des drogues et armes illégales montent des É-U vers le Canada, tout comme des flux de traite humaine.
Le Canada a vu récemment une hausse des demandes d’asile en provenance des É-U.
Ces enjeux nécessitent coordination, pas confrontation.
Et puis, il y a les œufs. Pendant la grippe aviaire, des œufs ont été contrebandés du Canada vers les É-U. Le petit déjeuner s’est retrouvé au cœur de la géopolitique.
7. Le Canada respecte ses engagements. Les É-U ? Pas toujours
Trump a imposé — puis retiré — puis menacé de réimposer des tarifs sur l’aluminium, le bois d’œuvre, les voitures, etc.
Et maintenant, il veut se retirer de l’ACEUM, qu’il a signé en janvier 2020 en le qualifiant de « plus équitable de l’histoire ».
Conclusion : un partenaire fiable mérite le respect
Le Canada est un allié stable, fiable, et économiquement stratégique.
- Il soutient les chaînes d’approvisionnement critiques.
- Il injecte des capitaux dans l’économie américaine.
- Il contribue à la défense continentale.
Le blâmer est non seulement injuste — c’est contre-productif.