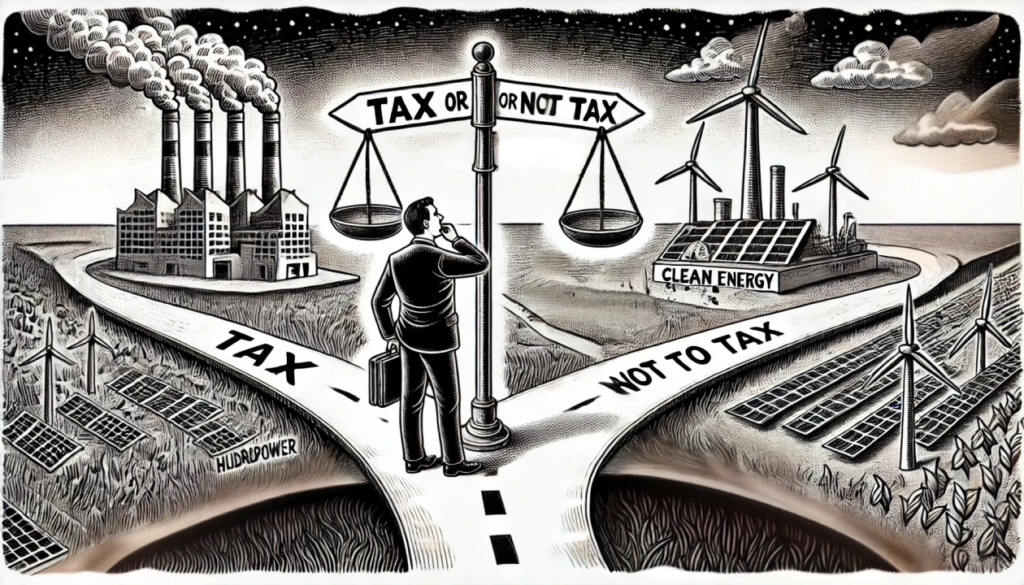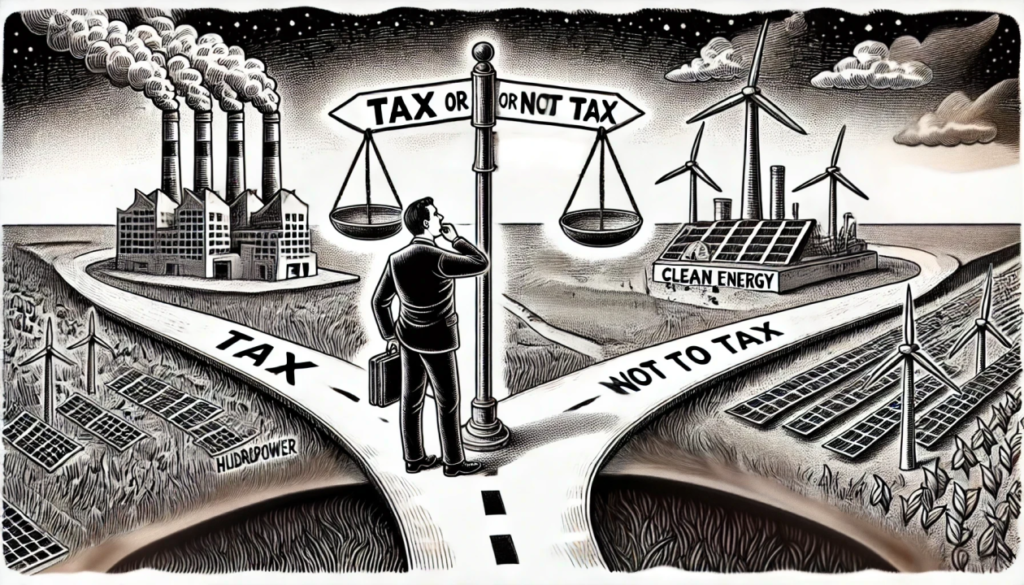
(LinkedIn: https://www.linkedin.com/pulse/taxer-ou-ne-pas-naviguer-sur-le-chemin-complexe-de-la-benoit-marcoux-j8mae)
La taxe sur le carbone est devenue un point central dans le débat électoral fédéral au Canada, reflétant le défi de concilier croissance économique, durabilité environnementale et soutien public. En tant qu’outil largement discuté pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, elle met en lumière la tension entre l’urgence de l’action climatique et les impacts économiques et sociaux des décisions politiques. Bien que la tarification du carbone soit importante, s’appuyer uniquement sur les signaux de prix est insuffisant pour parvenir à une transformation durable. Des comparaisons avec la transition des voitures à chevaux aux automobiles montrent qu’un succès dépend de l’innovation, mais aussi d’efforts concertés en vue d’établir des réglementations et des infrastructures, et non pas simplement d’une taxe sur le fumier.
Les objectifs des outils de politique carbone
L’objectif ultime des politiques carbone devrait être de réduire, voire d’éliminer durablement, les émissions mondiales de gaz à effet de serre. Pour y parvenir, il est nécessaire de déployer des outils stratégiques au fur et à mesure de l’évolution des technologies et des profils d’émissions. Cependant, des politiques axées sur l’efficacité à court terme risquent d’améliorer les systèmes d’énergies fossiles au lieu de promouvoir des alternatives zéro émission. Par exemple, des subventions visant à améliorer l’efficacité des centrales électriques au charbon pourraient réduire temporairement les émissions, mais prolonger la durée de vie de ces centrales, retardant ainsi les investissements dans les énergies renouvelables et augmentant les coûts à long terme.
Une stratégie plus efficace donne la priorité à un investissement précoce dans les technologies zéro émission, garantissant qu’elles peuvent être mises à l’échelle et devenir rentables avec le temps. La transition vers des systèmes propres dès que possible minimise le gaspillage de ressources et accélère la décarbonisation. Trouver cet équilibre est crucial : les politiques doivent éviter les perturbations économiques tout en obtenant un large soutien du public et des industries pour un changement transformateur.
Éviter les conséquences non intentionnelles
Les politiques carbone doivent prendre en compte les émissions mondiales en évitant les scénarios où les efforts nationaux déplacent les émissions en externalisant la production vers des régions avec des réglementations environnementales plus laxistes, sapant ainsi leur impact. Par exemple, l’externalisation de la production vers des pays comme la Chine, où le charbon domine le mix énergétique, a été associée à une augmentation des émissions mondiales malgré les réductions dans les pays occidentaux.
Les politiques doivent également minimiser les réactions négatives du public. Les taxes très visibles, par exemple celles imposées sur le carburant, peuvent être injustes envers les personnes qui n’ont pas accès à des options plus vertes. À la place, il serait préférable d’instaurer des subventions pour l’achat de voitures électriques ainsi que des amendes pour les voitures polluantes, lorsque des solutions alternatives existent, afin de promouvoir l’équité. De plus, les politiques doivent éviter la fermeture d’industries lorsque des alternatives durables ne sont pas encore développées, garantissant ainsi la résilience économique pendant la transition.
Innovation et changement structurel
La décarbonisation nécessite de l’innovation et des changements structurels, et pas seulement une redistribution des ressources. Un financement précoce de la recherche et du développement (R&D) public est essentiel pour créer et adopter de nouvelles technologies, qui peuvent ensuite être soutenues par des politiques de structuration du marché. Celles-ci incluent des subventions, des crédits d’impôt, des marchés publics, des mandats, des normes, des investissements publics directs et la tarification du carbone. Ces mesures établissent une base pour que les technologies propres gagnent en traction et dominent éventuellement le marché.
Les efforts devraient initialement se concentrer sur la promotion des industries renouvelables plutôt que de pénaliser l’utilisation des combustibles fossiles. Critiquer les systèmes existants sans présenter d’alternatives convaincantes n’aboutit à rien. À la place, mettre en avant et tester de nouvelles technologies propres dans des marchés de niche peut ouvrir la voie à une adoption plus large. Un soutien précoce, tel que des subventions et des crédits d’impôt, est crucial pour réduire les risques financiers qui dissuadent les investissements privés.
Le rôle de la tarification du carbone
La tarification du carbone est un outil polyvalent pour réduire les émissions, mais son efficacité dépend d’une conception et d’une mise en œuvre minutieuses. Au début de la transition, une tarification modérée du carbone pourrait ne pas encourager largement l’adoption de technologies vertes en raison de l’absence de substituts viables. Au lieu de cela, cette tarification peut conduire à des améliorations incrémentales de l’efficacité des combustibles fossiles ou à des déplacements sectoriels des émissions sans provoquer de changement structurel. Par exemple, une taxe carbone modeste pourrait encourager un passage du pétrole au gaz plutôt qu’aux énergies renouvelables.
Les systèmes de plafonnement et d’échange offrent une certitude quant à la réduction des émissions, mais introduisent une volatilité des prix, ce qui complique la planification à long terme pour les entreprises et les consommateurs. Cependant, ils présentent un avantage dans la collaboration interjuridictionnelle. Le système Québec-Californie illustre cette approche, harmonisant les objectifs régionaux et réduisant les émissions grâce à des cadres partagés.
À l’inverse, les taxes sur le carbone offrent une prévisibilité des coûts, favorisant les investissements dans des alternatives plus propres. Elles peuvent être plus facilement adaptées pour cibler les secteurs disposant d’options écologiques accessibles, comme la production d’électricité, tout en offrant des exemptions ou des taux réduits pour les industries difficiles à décarboner, telles que l’aviation ou la production de ciment. Cette flexibilité garantit l’équité et la praticabilité tout en encourageant l’innovation dans les technologies à faible émission.
En fin de compte, le choix entre les taxes sur le carbone et les systèmes de plafonnement et d’échange devrait refléter la préparation des secteurs et les objectifs régionaux, équilibrant les priorités environnementales, économiques et sociales.
Exploiter les politiques de structuration du marché tout au long du cycle de vie technologique
Les politiques de structuration du marché sont essentielles pour encourager l’adoption des technologies propres. Les différentes industries progressent à des rythmes distincts dans le développement technologique, nécessitant des approches ciblées. Les décideurs doivent reconnaître que plusieurs cycles de vie peuvent coexister simultanément dans différents secteurs :
- Étape précoce : Le financement public de la R&D pose les bases de l’innovation. Les laboratoires de recherche jouent un rôle clé en effectuant des R&D essentielles et en testant de nouvelles technologies avant qu’elles ne soient déployées à plus grande échelle.
- Étape de démonstration et de début de commercialisation : Les subventions et crédits d’impôt réduisent les risques financiers, permettant le déploiement initial de technologies propres. Les marchés publics accélèrent les projets de démonstration, prouvant la viabilité de ces solutions.
- Étape de croissance : Les mandats et les normes aident à établir des marchés pour les technologies émergentes, tandis que les banques vertes et les financements ciblés comblent les lacunes de financement. Les décideurs doivent équilibrer l’intégration des chaînes d’approvisionnement mondiales avec le développement des capacités locales pour les composants critiques, garantissant la résilience économique. Cette approche double crée non seulement des emplois, mais renforce également le soutien public en montrant les avantages tangibles de la transition.
- Étape de concurrence sur le marché : À mesure que la concurrence s’intensifie et que les économies d’échelle réduisent les coûts, des incitatifs déclinants peuvent encore combler les écarts de coûts, rendant les technologies propres plus abordables. Ces politiques facilitent une transition plus fluide pour les entreprises et les consommateurs vers des alternatives plus propres, réduisant les barrières financières et accélérant l’adoption généralisée.
- Étape mature : Les pénalités financières, telles que les frais sur les technologies traditionnelles ou la tarification du carbone, deviennent des incitations efficaces pour abandonner les technologies obsolètes et polluantes. À ce stade, les alternatives propres sont largement disponibles et compétitives, faisant des pénalités un moteur solide pour finaliser la transition.
Séquencement et maintien du soutien politique
Un séquencement efficace des politiques est essentiel pour atteindre des réductions d’émissions durables tout en minimisant les perturbations économiques et la résistance publique. Les mesures précoces, telles que les marchés publics, les subventions et les réglementations sont fondamentales pour établir de nouvelles technologies. Cependant, un retrait prématuré du soutien risque de permettre aux industries établies de reprendre leur domination.
Une fois que les alternatives propres sont largement disponibles et compétitives, des pénalités ciblées sur les technologies obsolètes peuvent renforcer davantage la transition. La prévisibilité des politiques demeure cruciale, y compris en amont de leur application, ce qui permet aux parties prenantes d’avoir confiance pour planifier et investir dans des transitions à long terme. Les décideurs doivent également planifier l’offre d’électricité propre pour la demande croissante, garantissant que les infrastructures suivent le rythme des besoins en électrification. Cet alignement permet d’éviter les goulets d’étranglement qui pourraient ralentir l’effort global de décarbonisation.
Plan intégré du système énergétique (PISE)
Un PISE est crucial pour des solutions énergétiques durables. Contrairement à des mesures politiques isolées, un PISE adopte une approche globale de la gestion de l’énergie, intégrant diverses sources d’énergie, des prévisions de demande, des technologies, des infrastructures et des chaînes d’approvisionnement pour optimiser l’efficacité et la durabilité. Ce plan répond au besoin immédiat de réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en garantissant la sécurité énergétique et la résilience économique à long terme.
Un PISE organise et intègre les efforts dans des secteurs clés, tels que l’électricité, les transports et l’industrie. En intégrant les progrès réalisés dans les énergies renouvelables, le stockage d’énergie, les technologies des réseaux intelligents et les solutions client décarbonées, un PISE vise à optimiser l’offre et la demande, réduire les inefficacités et améliorer la fiabilité du système. Cette approche est conçue pour soutenir la transition vers une économie à faible émission de carbone tout en répondant aux défis liés à la sécurité énergétique et à la durabilité.
Conclusion
La question de taxer ou de ne pas taxer illustre le défi plus large de la prise de décision en situation d’incertitude. Les décideurs doivent évaluer les risques, considérer les conséquences et aborder les préoccupations éthiques et pratiques pour tracer une voie à suivre. À l’image du dilemme existentiel d’Hamlet, «?être ou ne pas être?», les choix en matière de politique carbone sont empreints de complexité et d’enjeux d’une grande importance. Pour accélérer la transition énergétique, les gouvernements doivent utiliser une boîte à outils variée et dynamique, en séquençant et en calibrant soigneusement des politiques prévisibles afin de favoriser l’innovation, réduire les émissions et atteindre les objectifs climatiques mondiaux. La lutte pour décider reflète le besoin plus large de courage et de prévoyance face aux incertitudes de notre avenir commun.